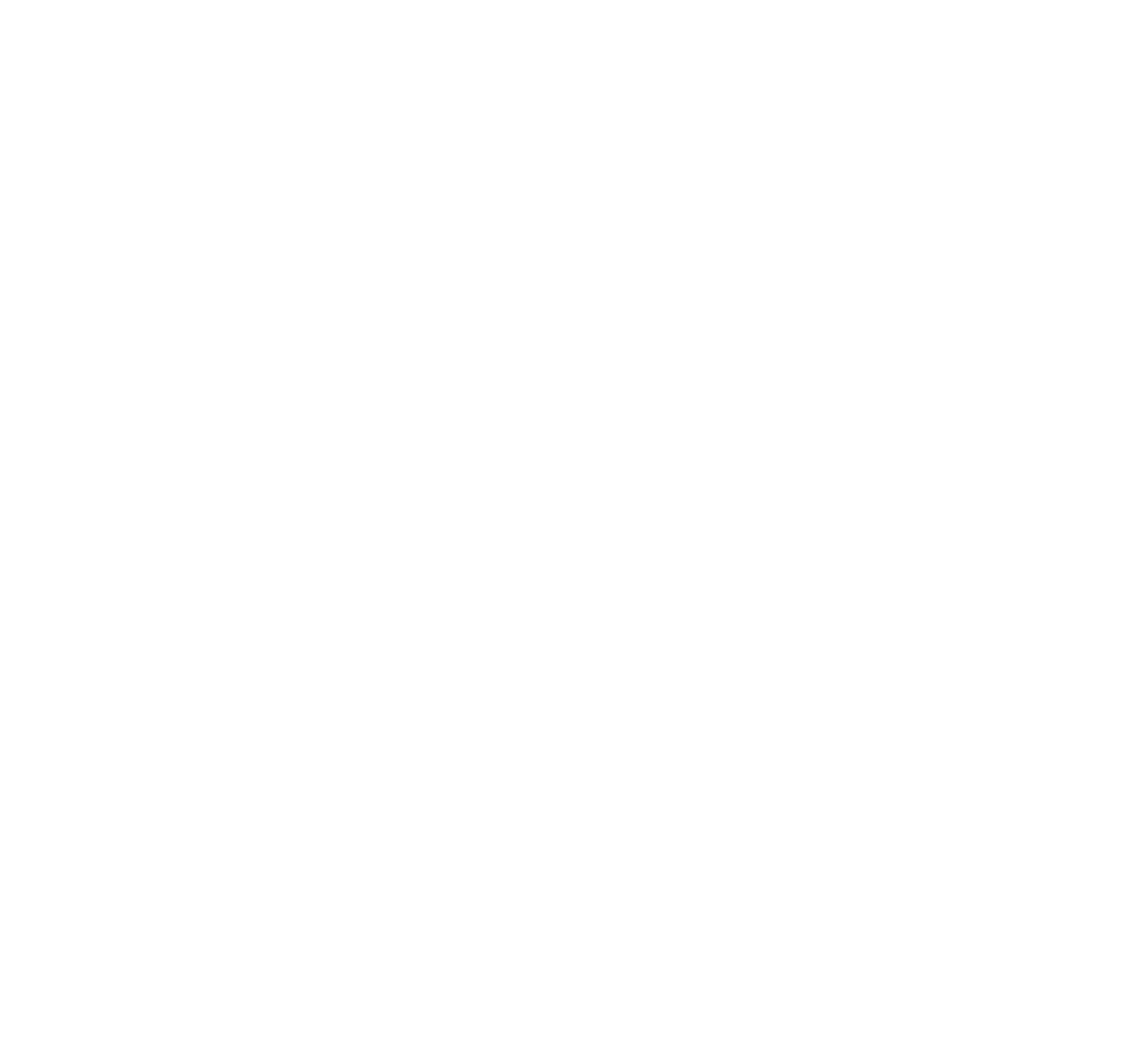Interroger la féminité, puis les féminités, la féminitude d’une manière plus globale, a toujours beaucoup occupé les hommes. Les femmes aussi, mais il faut dire que leurs réflexions nous sont moins parvenues que celles de leurs contemporains, l’histoire ayant beaucoup été écrite au masculin. Puis, si on vise le début du 20ème siècle pour la première vague féministe, les années 70 pour la seconde, les années 90 pour la troisième, les femmes ont beaucoup pris en charge les réflexions sur les genres, notamment le genre féminin, son existence intrinsèque ou sa construction uniquement sociale, le fait qu’on ne nait pas mais qu’on devient, ou qu’on nait mais que ça ne doit pas empêcher de devenir, si être une femme n’est pas être un homme, est-ce que c’est quand même être Homme, ou est-ce que cette majuscule n’est qu’une manière polie de continuer à exclure plus de la moitié de l’humanité ; être humaine, cela implique-t-il socialement d’être homme quelque part ? Tout ça pour dire que sur le sujet du féminin (dont on aura assez vite conclu qu’il n’est pas un sujet, mais le regroupement d’une multitude) et donc plus justement des féminins, les écrits (réflexions et interrogations, pas que écrites d’ailleurs) sont nombreux, inventifs, contradictoires, foisonnants.

Il ne faut pas être injuste, de très beaux écrits existent aussi sur la/les masculinité·s, écrits, réflexions, interrogations mais… ça foisonne moins, dira-t-on. Sur les scènes de théâtre, ça ne foisonne pas des masse non plus, là où l’interrogation du genre féminin, de ses représentations, est de plus en plus répandue, proposée (moi-même j’entre dans la mouvance avec Phèdre/Salope). C’est-à-dire qu’on ferait porter sur les féminins l’interrogation – l’hébétude – de la différence des sexes, et de la construction sociale qui en a découlé en Occident (je précise ici Occident, et c’est quelque chose qu’on pourrait rajouter à presque chaque phrase, Occident, Occident, Occident, que ce soit bien clair d’où on parle, et d’arrêter de croire – ou faire croire – qu’on a une parole dénuée de déterminismes géographiques, historiques, sociaux, ce qu’on regrouperait sous le terme « culturels »). La différence des sexes est fondamentale dans l’histoire de nos sociétés (occidentales), surtout depuis le succès bœuf du christianisme. Bien entendu, avant, chez les Romains Antiques ou les Grecs, les femmes étaient déjà considérées comme des mineures, utiles surtout à la procréation, ce qui était vraiment un mal pour un bien (relisez Aristote à ce sujet c’est un plaisir sans cesse renouvelé), mais les Chrétiens arrivent en Europe (une Europe qui en grande partie était restée ancrée dans des paganismes où si la différence des sexes n’était pas ignorée, beaucoup de force et de pouvoir étaient attribués au féminin, dans des notions de transmission, de guérison, de sorts aussi) avec une idée phare qu’ils vont réussir à ancrer dans beaucoup d’esprits : la femme (Ève, première entre toutes) non seulement est née du corps masculin (qui est directement lié au divin lui), mais en plus est la cause de la Chute. Patatraf. C’est Augustin qui gagne, dans sa lecture de la Genèse, alors que franchement, à la lecture, ça prête à confusion : d’abord Dieu crée un être et il est écrit « homme et femme il les/le fit », puis plus tard c’est dit qu’il crée Adam, qui s’ennuie, et donc à partir de sa côte / ou de son côté ! / il crée Ève : Augustin choisit que la première version est une généralité que la deuxième version vient expliciter, et bien entendu c’est « côte » et pas « côté », donc Dieu → Adam → Ève → Chute ; mais on aurait aussi pu lire que Dieu crée un être androgyne, qu’il nomme Adam, mais comme cet Adam s’ennuie dans sa complétude, Dieu le sépare en deux – on rejoint l’idée d’Aristophane pour expliquer l’amour humain – et dans ce cas, si Ève est responsable de la Chute, elle n’est pas moins divine qu’Adam – qui aurait pu faire preuve d’un peu plus de caractère – alors on a Dieu → AdamÈve (ou ÈvAdam) / Dieu → Adam et Dieu → Ève / Ève → Adam → Chute, et c’est pas tout à fait pareil. Enfin, les femmes sont toutes les filles d’Ève, et le modèle unique qui leur est proposé (en modèle positif, en négatif il y en a beaucoup) c’est la Vierge. Voilà, l’accomplissement pour une femme, c’est d’enfanter sans être salie par les affres de la sexualité, la leçon est donnée, les sorcières sont brûlées, les mystiques sont légion…
Il s’agit bien sûr d’une version extrêmement simpliste, voire un peu bête des choses, et c’est oublier tant et tant de nuances, qui font du Moyen-Âge et de la Renaissance par exemple des ères d’un certain empowerment féminin, qui font de l’absolutisme un retour à un certain obscurantisme masculiniste, de la fin du 18ème siècle un moment de grands espoirs, de grandes tentatives que vont étouffer les peurs et les interêts bourgeois du 19ème, peurs et intérêts financiers étant, on le sait, fortement liés. Mais ce résumé simpliste et bête, en forme de tendance très générale, est là pour marquer un point : depuis des siècles, une des charges du féminin, qu’on étudie, qu’on enferme d’un côté, qu’on expose de l’autre, c’est d’être le représentant de la différence des sexes, ce machin qui nous préoccupe depuis un bout de temps (pourquoi différent·es, si différent·es que ça, vraiment ?), et donc le côté du termomètre sur lequel on agit pour maintenir une température adéquate. Le féminin, c’est l’Autre, c’est le point de chauffe. Par exemple, avant la Révolution, l’idée était répandue non pas tant qu’il fallait de la liberté pour tout·es et de l’égalité entre chacun·es, mais que le pouvoir s’était dévirilisé, avait été contaminé par la présence des femmes, leur perfidie naturelle et tout ce que vous voulez. Le féminin était l’explication du péréclitement du pouvoir royal, on aurait dû le voir venir. Alors quoi ? Alors après, dans les Assemblées, constituantes, nationales, les femmes, c’est en haut, et sans droit de rien. Alors quoi ? Alors les hommes, c’est en sombre et en moche, parce que les couleurs et le beau, c’est pour les nobles, et même pire, c’est pour les efféminés. Le point de chauffe et de rupture, par là où l’humanité occidentale passe d’un état à un autre. Pour étudier une société, concentrez-vous sur les femmes. Pas plus imbécile qu’une autre idée, vous me direz, les femmes étant en Occident sujettes aux lois masculines (avec encore une fois des nuances qu’il faudrait ajouter). Ce que les femmes sont autorisées à faire (puisqu’il s’agit bien de ça), l’étendue de leurs libertés ou plutôt la superficie de leur pré donne une idée très précise de l’hummanité (par humanité, j’entends : conscience d’être humain·es, interrogation sur le bonheur, questionnement du vivre ensemble).
Donc, tout ça pour dire, des femmes et surtout de ce que doit être / est / sont / devraient / pourraient / être le·s féminin·s, il y a matière, et pour cause.
Mais sur le·s masculin·s ? C’est comme si, finalement, le masculin-masculin (qui serait représenté par l’homme hétérosexuel cisgenre) n’était pas interrogé dans ses représentations ou ses performances parce qu’on voudrait croire qu’elles sont immuables. Que le masculin, comme Adam, c’est la base, le poteau planté profond autour duquel l’humanité tourne.
D’où le titre de cet article : est-ce qu’il faut être pédé pour questionner la masculinité ?
Au théâtre, si c’est de théâtre dont il s’agit, des hommes ont interrogé la masculinité, comme Copy (pédé), Lagarce (pédé), Koltès (pédé), Genet (pédé). L’investissement des artistes homosexuels dans l’interrogation des masculinités a permis de poser plusieurs jalons : d’abord, la pluralité possible de l’expression de sa masculinité. Genet ou Fassbinder, quand ils mettent en scène un homosexuel, ils ne mettent pas en scène un homme qui se comporte comme une femme, mais un homme qui se comporte comme un homme qui ne se comporte pas comme la majorité des hommes. Et ils font apparaître le corps masculin comme un corps désirable. On dira : ah oui mais dans les couples hétérosexuels (nombreux parmis les héros et héroïnes dramatiques), les hommes sont désirés par les femmes, donc désirables ! Oui mais non. Parce que le théâtre qui nous est parvenu et nous sert de répertoire, interdit aux femmes (en conformité avec les valeurs sociales de l’époque) l’expression d’un désir charnel (ça en ferait des sorcières, puis des hystériques), alors si elles désirent les corps des hommes, elles le font passer par d’autres biais (ou s’expriment et sont folles, nymphomanes, monstrueuses, puisqu’elle réduisent un homme ou des hommes à l’évocation charnelle, ce qui est délictuel, vu que l’homme est quand même issu du divin !) Et le théâtre des femmes alors ? Il y a celui qu’on redécouvre, grâce au travail d’Aurore Évain par exemple, et celui qu’on dit « contemporain », de Duras à Lidell, où effectivement la masculinité et l’attrait des corps masculins est abordé, exploré, mais… depuis les yeux de l’Autre. On voit le désir sucité par le corps masculin à travers des personnages de femmes, de pédés, de transgenres, de travesti·es. Alors là, moi, ça me fait plutôt plaisir et c’est agréable à lire/jouer/monter, mais quand même : la masculinité quand elle n’est pas « déviante », ou interrogée depuis sa déviance (sa marginalité), ou depuis le regard de « l’autre genre », elle est où ? La masculinté quand elle se sait désirable par son expression physique, elle apparaît quand ? C’est à-dire la masculinité qui se sait, se nomme, se parle ? Elle est où dans un pays où en ajoutant une majuscule à la moitié de l’humanité, on imagine désignier l’humanité entière, et en faire un musée (ça ne choque personne le musée de l’Homme ?) ?
Virginie Despentes a dit, dans une interview sur Radio Nova, quelque chose de précieux : “Moi j’ai l’impression que les mecs sont vachement lents sur des trucs extrêmement simples : ils sont extrêmement lents à porter des jupes, extrêmement lents à se maquiller, extrêmement lents à se vernir les ongles, extrêmement lents quand ils sont beaux à se servir de leur corps, exception faite des milieux queer (…). Je les trouve extrêmement lents à s’emparer de sujets qui les concernent directement et qui pourraient les concerner exclusivement, comme le viol. Comme quand il y a Nuit debout et qu’on commence à entendre que beaucoup de jeunes filles qui restent la nuit se plaignent de mains au cul (…), ça me surprend que le lendemain les mecs n’éprouvent pas le besoin de se rassembler immédiatement pour dire : qu’est ce qu’on fait ? (…) Je trouve les mecs extrêmement lents à s’emparer de la question de la masculinité (…). A chaque fois qu’un mec viole, ça les concerne tous, au sens ou c’est leur virilité qui s’assoit là-dessus. Quand ils se trimbalent en ville en maîtres du monde, c’est sur le travail des violeurs qu’il s’appuient.”
C’est on ne peut plus clair.
Alors, si on considère que les arts vivants sont encore les reflets de la société, ou d’une partie de la société, si on considère que le théâtre par exemple, dont j’aime à croire qu’il est une jonction très étrange entre un art bourgeois et un art de la contestation, sait s’emparer de sujets complexes, douloureux, déroutants (les guerres, les terrorismes, les sexualités, l’ultra-violence… on peut citer Kane, Schwab, Bernhardt, Handke, Genet, Duras, Sarraute pour les auteurs et autrices, on peut dire Castellucci, Lidell, Garcia, Lafont, Régy pour les metteur/ses en scène…), comment se fait-il qu’il soit si peu question des masculins ? Combien de fois voit-on une femme sur un plateau qui pour s’adresser à nous, public, affirme sa parole comme étant féminine, et par là-même inclut dans la pensée du spectacle cet aspect : cette parole est aussi une exploration d’un féminin ? Et combien de fois voit-on un homme faire de même ? Comme dit plus haut, l’homme pouvant jouer de sa majuscule, un homme qui dit sur le plateau qu’il est un homme, on peut y entendre, et on y entend souvent qu’il est un humain. Il y a donc un problème sémantique fort. Je suis sur un plateau, seul (comme dans mon seul en scène Awake), et je dis : je suis un homme, est-ce qu’on y entend que je parle depuis un masculin ? Non, alors je rajoute : je suis un monsieur. Et pour qu’il n’y ait plus de doute, je dis que je suis pédé, et là, les oreilles se dressent pour entendre cette masculinité qui s’exprime. La masculinité exprimée par les homosexuels est devenue sur les plateaux un genre théâtral en soi, ou plutôt une habitude de contournement : c’est le moyen qui semble le plus aisé pour qu’un acteur prenne en charge les questionnements liés à la masculinité. L’autre moyen, c’est la mise en scène du couple hétérosexuel. On pense à la Maison de Poupée de Ibsen par exemple : c’est en mettant en scène un couple hétérosexuel dans une société bourgeoise du 19ème siècle, et en interrogeant spécifiquement la place accordée à la femme dans ce couple et ses possibilités d’épanouissement, ou tout du moins d’action, que la masculinité de son mari est mise en question. Le point, c’est que si la masculinité est un thème abordé, il l’est souvent par des détournements, et en deuxième lieu. C’est souvent un effet de miroir : on interroge explicitement la marge, et donc ça rebondit sur la norme, on interroge explicitement l’autre, alors ça rebondit sur l’un. Je parle ici des spectacles où ces questions sont abordées, et n’érige pas en principe que ces questions doivent être abordées, on peut avoir un spectacle sur un couple hétérosexuel dont le questionnement se porte sur autre chose que sur les genres et les représentations liées des deux rôles (par exemple le spectacle de Gérard Watkins Identité).

Le titre de l’article aurait donc dû être : faut-il être pédé ou une femme pour questionner la masculinité ? On tourne depuis le début autour d’un trou noir, qui est la prise de parole sur soi, par soi. La masculinité, les masculinités semblent être un angle mort de la réflexion de nombre de metteurs en scène. C’est-à-dire les masculinités détachées de la notion d’universel. Les penseurs (s’ils méritent ce nom) qu’on entend le plus (dans les médias à large rayonnement) et qui s’y attellent, sont ceux qui expriment le regret d’une masculinité flamboyante, rugueuse, masculinité des héros et des patriarches, tuée par des années de féminismes sauvages. Alors, ce qu’ils regrettent, c’est une masculinité virile, qu’ils opposent à la féminisation supposée des hommes contemporains. Une génération de tafiolles. Est-ce à dire que la virilité est l’apanage de la masculinité ? Et sur les plateaux de théâtre, les personnages masculins sont-ils nécessairement virils ? Non. Les personnages de Tchekhov ne sont pas nécessairement virils, ceux de Racine ou de Molière non plus, et même, la virilité (ensemble fluctuant fait de courage, sens de l’honneur, sens du devoir) est assez souvent interrogée, directement cette fois ci, depuis la naissance du théâtre (je pense à Hippolyte chez Euripide). L’homme viril, héroïque, qui se soucie de grandeur, de conquêtes, de conservation, de patriotisme, de sacrifice, pose des questions aux auteurs et aux metteurs en scène, de manière encore une fois détournée (si on s’entend que masculinité et virilité ne sont pas les deux côté d’une même pièce) : faut-il être viril pour être un homme ? Abandonner sa virilité à l’amour d’une femme, par exemple (le Cid), est-ce encore être un homme ? Et là, on pense au travail de Louis-George Tin sur l’Invention de la culture hétérosexuelle.
Donc, j’ai exagéré au début, les masculinités et leurs représentations ne sont pas ignorées sur les plateaux et dans les écrits dramatiques. Elles sont questionnées aux moyens de détournements (sexualité marginale, questionnement du couple dans ses postures genrées), et à travers les concepts phares de virilité et d’héroïsme, qui posent un rapport assez simpliste : toute compromission à sa virilité diminue-t-elle l’homme dans sa masculinité ? Mais quand même, se questionner sur ce qui fonde un homme dans son genre semble être très inquiétant, puisque si peu abordé frontalement. Je suis un homme et ça se passe bien pourrait être le titre d’une œuvre chorégraphique forte. Interroger la masculinité, les masculinités de manière directe, non détournée, comme on a pu le faire et comme on le fait encore quand il s’agit de féminins et de féminités, c’est-à-dire poser sur le plateau un homme comme étant l’un des représentants de son genre, restreint dans son expression à la moitié de l’humanité, serait un acte fort, utile, précieux, aussi précieux que de poser des Blanc·hes sur un plateau en tant que Blanc·hes, des bourgeois·es en tant que bourgeois·es : parce que le vrai défi que nous présente le questionnement des masculinités par d’autres personnes que des femmes ou des pédés, c’est celui du questionnement de l’hégémonie, des pouvoirs, de l’universlisme et des privilèges.
Matthias Claeys
Photos : (c)Ryan McGuire
Petite bibliographie :
EVAIN Aurore et al. Théâtre de femmes de l’Ancien Régime. Publications de l’Université de Saint-Etienne, La cité des dames, 2006
Dominique Godineau, Les femmes dans la société française, 16ème-18ème siècle, Armand Collin, 2003
VIENNOT Éliane. Non, le masculin ne l’emporte pas sur le féminin ! Petite histoire des résistances de la langue française, éditions iXe, 2014
BUTLER Judith. Trouble dans le genre, le fémimisme et la subversion de l’identité. Trad : Cynthia Kraus. La Découverte, poche, 2006.
BADINTER Élisabeth. La ressemblance des sexes. Le livre de poche, 2012.
GROULT Benoîte. Le féminisme au masculin. B. Grasset, 2010.
TESTART Alain. L’amazone et la cuisinière : anthropologie de la division sexuelle du travail. Gallimard, Bibliothèque des sciences humaines, 2014.
IRIGARAY Luce. Speculum de l’autre femme. Les éditions de minuit, collection « critique », 1974.
DE BEAUVOIR Simone. Le deuxième sexe 1, les faits et les mythes ; 2, l’espérience vécue. Gallimard, Folio-Essais, 1993.
KRISTEVA Julia et CLÉMENT Catherine. Le Féminin et le sacré. Stock, 1998.
KRISTEVA Julia. Le génie féminin. Gallimard, Folio-essais, 1999-2002
WITTIG Monique. La pensée straight. Editions Amsterdam, 2007
FOUCAULT Michel. Histoire de la sexualité. Gallimard, 1976-1984.
TIN Louis-Georges, L’invention de la culture hétérosexuelle, Éditions Autrement, 2008